

Mais de 1792 à 1794, les armées françaises dévastèrent à nouveau le château qui ne fut plus entretenu par les propriétaires suivants. Madame de Rodoan fit les réparations nécessaires après avoir demandé l’autorisation au conseil municipal de faire des coupes de bois.
Enfin, la triste union de la dernière héritière des Rodoan avec le marquis de Brancas vint hâter la ruine du domaine de Fontaine-l’Évêque. Le château fut mis en vente mais ne trouva pas d’acquéreurs et fut racheté par le consortium des créanciers. Le mobilier d’époque fut quant à lui vendu et dispersé aux enchères publiques.


Le
9 mai 1864, Clément Bivort en devint possesseur. Le château d’une étendue
de huit hectares, se composait de cette façon : Le château
comprenant un vaste bâtiment composé du corps de logis, chapelle, tours
et dépendances, restant de constructions plus importantes avec de grandes
portes et grilles d’entrée, avenue plantée, cour avec pelouses,
bassins et plantations, jardins potagers, terrains, pelouses et jardin
d’agrément, canal, étang, clos, pavillon, terrain planté et prairie.
Clément Bivort, en 1869, confia aux soins de l’architecte carolorégien Auguste Cador, sa restauration. Celle-ci fut intelligente. Il garda à chacune des pièces son style :
C’est ainsi que l’on a conservé à la plupart des appartements leur décoration de style Louis XVI et à la chapelle sa façade Louis XIV, tandis que les façades du château proprement dit appartiennent à l’époque de la Renaissance. Construites en moellons et pierres de taille, elles sont percées de fenêtres à meneaux récemment réédifiés. Il existait à l’endroit où s’élève aujourd’hui le hall une lourde construction datant du siècle dernier et dont les façades étaient en briques avec chaînes et angles en pierre de taille ; une partie de cette construction fut démolie et une autre, remaniée, a été transformée en un halle de style Renaissance. Cette salle est ornée d’une fort curieuse cheminée en grès provenant du château de la Jonchière, voisin de celui de Fontaine et encore existant. Le manteau de cette cheminée est décoré de trois blasons sculptés dont deux entourés de couronnes de feuillage en fort relief.


Les armoiries sont :
- celles,
deux fois répétées, de Denis de Jonchière, seigneur de
Leernes (d’or à la face de gueules chargées de trois roues à
six rayons d’argent)
- écu parti de la Jonchière et de Hertoghe. Cette famille portait : écartelé aux un et quatre d’or au rencontre de cerf et de gueules ; aux deux et trois d’argent à la face échiquetée de gueules et d’or de deux traits.
Denis de la Jonchière, avait en effet épousé Marie de Hertoghe, dame de Heyhoeck, fille de Corneille, échevin de Gand, et d’Anne d’Exaerde, elle mourut le 13 mai 1659. La décoration de cette cheminée qui est un travail assez grossier, mais d’une belle silhouette, est complétée sur les retours du manteau, par des guirlandes en formes de médaillons renfermant des têtes d’empereurs romains.
L’extrémité de la construction qui contient ce hall forme une tour carrée en brique et pierres, terminant la façade vers l’entrée principale du domaine. A part cette tour moderne, il en existe encore trois anciennes faisant corps avec le château, et deux autres isolées ; on a retrouvé de plus les traces des différentes tours détruites.
Le château fut occupé par les derniers seigneurs de Fontaine jusqu’à son acquisition par la ville.
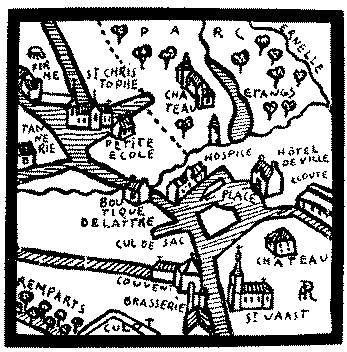
Le château vu par Louis Delattre, écrivain fontainois
(Reproduction interdite)
Louis Delattre a tracé de mémoire
le plan de la ville
pour illustrer un conte.
Il a négligé la Babelonne.
Sa superficie était de dix hectares et comprenant le café-hôtel (coin de la rue de la Bouverie avec la rue du château) ainsi que la ferme du château. L’entrée du château était bordée de superbes ormes.